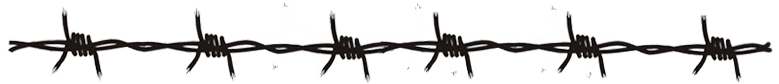Pina (ANTIDIGOS)
Pour mieux connaître un lieu chargé en histoire, rien de tel qu’un angle subjectif, personnel et qui sent le vécu ! Sous la chaleur du soleil de Bari, dans l’enceinte de la Caserma Rossani, interview en compagnie de notre ami Pina, chanteur du groupe de punk Antidigos. Activiste au sein du lieu, il a laissé beaucoup de lui-même dans ces bâtiments et ne compte pas faire l’économie de l’énergie qui lui reste. Un témoignage qui nous a beaucoup inspiré. Force à lui et à toutes les personnes du collectif. | Propos recueillis par Polka B.

Comment le squat a-t-il été ouvert ?
Pina : Le bâtiment a été abandonné il y a très longtemps. En réalité, nous sommes arrivés ici suite à l’expulsion d’ un autre lieu (Villa Roth, NDLR). Après plusieurs AG, tous les camarades de la région ont réunit leurs forces. Les gens venaient de plein de réalités culturelles et politiques, cela allait des skinheads aux gens du hip-hop, en passant par les autonomes. On a fait un cortège dans la ville de Bari, et vers la fin nous sommes tous rentrés dans ce bâtiment.
L’idée, c’était d’ouvrir un centre social autogéré en plein centre-ville. Avec le temps on a créé un gymnase populaire, un théâtre, une bibliothèque, une salle de danse, un atelier de sérigraphie… Ici, il y a toujours eu une diversité de personnes et d’activités. Depuis le covid, beaucoup de lieux autour de nous ont été affaiblis.
Il faut reconnaître que nous avons perdu beaucoup de gens et la motivation de faire des choses. Notre but, c’est donc de renforcer notre espace avec la mise en place de nouvelles activités. Actuellement, il ne reste que les fidèles et c’est aussi mon cas, car je n’imagine pas ma vie en dehors de ce type d’espace.
Le potentiel de Bari est énorme mais bien souvent, les gens d’ici n’arrivent pas à le voir. Moi et d’autres, nous venons des provinces aux alentours. Nous avons ce regard extérieur qui permet de voir la ville d’un autre œil.

Comment se fait-il que les gens qui fassent vivre ce lieu ne viennent pas directement de Bari ?
Quand tu viens d’une ville, le centre social est à côté de toi, et tu as juste à décider si tu veux y aller ou non. Quand tu viens d’un village, tu rêves d’avoir un lieu tel que celui-ci. C’est pour cela qu’on s’est cassé la tête pour le faire vivre. Des fois, tu te rend seulement compte de ta chance au moment où tu perds les choses pour de bon. C’est une terrible réalité.
Lors de l’ouverture, avez-vous dû faire face à la mafia locale ?
Nous avons effectivement dû affronter ce problème. Les premières années, nous avons eu des soucis de deal. Il y a eu pas mal de bagarres par rapport à ça. C’est le sud de l’Italie. Tout dépend de ta capacité à négocier, en lien avec les gens du quartier. Si tu es isolé par rapport à la mafia, tu ne fais pas le poids. C’est un carnage.
C’est moche à dire, mais nous nous sommes appuyés sur des intermédiaires du même milieu qui parlent le même langage. Pour faire court, des gens importants du quartier se sont interposés pour nous défendre.
Il faut être réaliste. Il n’y a pas que la logique politique, il y a aussi la logique de la rue. Nous croisons ces personnes tous les jours, dans les bars et dans la vie quotidienne. À un moment donné, à force de se croiser, il y a une reconnaissance mutuelle. Ici c’est un quartier très populaire. Les punks ont réussi à bien se débrouiller.
Au sein du centre social, comment organisez-vous les prises de décision ? Quelle est votre vision politique commune ?

La meilleure façon de répondre à cette question, c’est de parler d’humilité. Ici, ce n’est pas comme Rome, Turin ou Bologne car nous sommes vraiment très peu nombreux. Un autonome, un punk, et un skinhead vont marcher ensemble.

On met souvent nos différences politiques de côté, qu’elles soient anarchistes ou communistes.
Si nous n’avions pas réfléchi comme cela, ce lieu n’aurait jamais existé.
On sait qu’on est différents, mais nous voulons faire des choses ensemble. C’est le plus important. Globalement, la ligne politique de cet endroit, c’est l’antifascisme.
Ici, vous faites des distributions alimentaires pour les réfugiés. Comment réagit la police locale face à ces actions ?

Cela ne leur a pas plu mais ils nous ont laissé faire. Nous étions en zone rouge par rapport au covid. Comme nous ne pouvions plus faire de concerts, on s’est concentrés sur les besoins primaires que pouvaient avoir les gens. Le fait de distribuer des repas nous a beaucoup plus inscrits dans la vie du quartier. On a rencontré plein de nouvelles personnes.
Les gens crevaient la dalle ici, et en plus ils avaient peur. Le besoin était énorme. On a quand même du régler quelques conflits. Par exemple, certains italiens voulaient passer devant les migrants lors de la distribution. C’étaient de vraies embrouilles, attention.
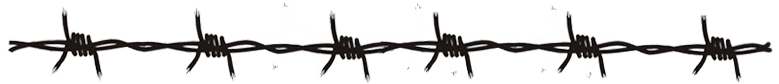
Parlons un peu de toi si tu veux bien. Tu viens de la ville d’Andria. Comment as-tu découvert le punk ?
Le punk a eu son histoire à Andria. De nombreux espaces autogérés existaient à l’époque. Les premiers punks ont fait un gros travail pour attirer des groupes. J’allais à ces endroits pour rencontrer des gens, fumer un peu… ce genre de trucs.
Et puis, les plus grands m’ont invité à venir aux concerts. J’en ai vu un, et je suis tombé dedans ! Ici, la mentalité est beaucoup plus borderline qu’à Bari.On monte des TAZ (Temporary Autonomous Zone) éphémères pour organiser des soirées par exemple. La réalité c’est qu’aujourd’hui, les jeunes partent massivement. En particulier en France pour bosser lors des saisons.
Quelle a été ta motivation pour monter ton groupe Antidigos ? Avais-tu des modèles ?

Quand j’étais petit, j’allais tout le temps aux concerts. Je me mettais déjà à écrire. J’avais la passion du micro, même si je ne savais pas chanter (et c’est toujours le cas!).
Les messages politiques étaient très importants pour moi. J’ai fait mon éducation dans les lieux autogérés, entre musique et politique. Un jour, j’ai pris le micro dans une jam session. Mes potes ont kiffé et ils m’ont encouragé.
J’étais à Rome en 2011. Stefania du groupe Cloaca Maxima m’a beaucoup aidé à perfectionner mon chant. En 2013 je suis allé à Londres, et le punk est devenu ma drogue. Quand je suis revenu, nous avons commencé à occuper la Caserma. Entre amis motivés, on s’est réunis pour former Antidigos. Je suis le seul membre de la formation originale. On continue de renouveler le line-up pour faire vivre le projet.
C’est une famille. Avec les tournées, on ne peut pas voir le groupe autrement.
Que signifie « Antidigos » ?
La « digos » en Italie, c’est une unité de policiers en civil qui te prennent en photo lors des manifs etc. C’est la police la plus dangereuse que nous connaissons. Comme nous avions plein d’embrouilles avec eux dans la rue à Bari, on a spontanément choisi ce nom.
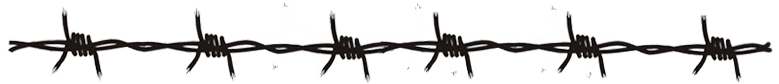
Que penses-tu de la scène punk DIY italienne ?
Il faut d’abord préciser une chose. En Italie, il y a la scène du nord et celle du sud. Dans le sud, je trouve que le volet politique est un peu plus affirmé. Ce n’est pas un jugement de valeur, les expériences que j’ai vécues dans le nord étaient magnifiques. Une chose est certaine… ici ce ne sera jamais Berlin !
En Italie, les traditions ont encore la peau dure. Il y a beaucoup de travail à faire. Surtout dans le sud où quand tu débarques d’un concert punk on te regarde vraiment comme si tu étais un fou.
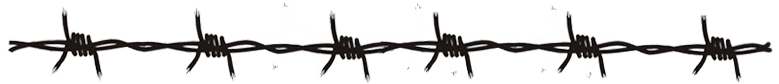
Comment vois tu le futur de la Caserma ?

Malheureusement, dans deux ans, cet espace va devenir l’Académie des Beaux-Arts. Du coup, on réfléchit à investir d’autres bâtiments construits aux abords du même terrain. On est train de voir la meilleure façon de les aménager. La Mairie a dit qu’elle ne souhaitait pas nous expulser, mais l’enjeu économique est particulièrement fort.
Se dresser contre un projet d’ordre culturel, ici à Bari, ce n’est vraiment pas évident. La Mairie voulait nous construire un bâtiment et nous le laisser mais nous avons refusé. On préfère rénover nous-mêmes des bâtiments déjà existants ici.
Donc, on reste. On va voir ce qui va se passer. Peut-être qu’on se mettra sur le toit et qu’on résistera !